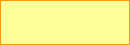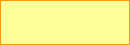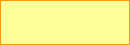
Le Maroc indépendant
- Devant les attentats nationalistes d'abord dans les villes puis en milieu rural et toutes les pressions populaires, la France rétablit Mohammed V le 16 novembre 1955 avant de signer les accords de La Celle-Saint Cloud marquant l’indépendance du pays le 2 mars 1956.
- Mohammed V, devenu roi, signe le 7 avril la fin du protectorat espagnol sur le Nord.
- La ville de Tanger retourne au giron marocain le 29 mai après l'admission du pays à l'Organisation des Nations Unies.
- Puis c'est la province de Tarfaya qui est récupérée des mains des Espagnols en 1958 ; la même année, le Maroc intègre la Ligue arabe et l'Organisation de l'Unité Africaine.
- Les premières années d'indépendance sont marquées par l'alphabétisation et l'éducation des masses populaires et la modernisation des lois, particulièrement celles concernant les droits de la femme.
- En 1961, Mohammed V décède et son fils, Hassan II, lui succède.
- Il lance des réformes à tous les niveaux, notamment celle de la constitution, institue un système bicaméral qui échoue (le pouvoir législatif est alors du ressort du roi pour quelques années) et pratique une diplomatie très active.
- Le Maroc vit pendant cette décennie une crise socio-économique qui sera résorbée petit à petit ; l'opposition grandit, surtout venant des partis d'avant l'indépendance (Istiqlal puis Union Nationale des Forces Populaires notamment) ; toutefois, le pays connaît un pluralisme politique et une démocratie embryonnaire inexistante dans la plupart des pays à l'époque.
- Une crise franco-marocaine surgit quand Mehdi Ben Barka, fondateur et secrétaire général de l'UNFP, exilé en France puis condamné à mort par contumace, disparaît à Paris en 1965.
- La libération des zones occupées se poursuit.
- Dès 1963, le Maroc, d'abord par la diplomatie puis par les armes, intervient en Algérie maintenant indépendante, pour récupérer ses territoires orientaux, notamment Tlemcen et Tindouf.
- Mais les socialistes algériens refusent, combattent et gardent les territoires marocains pris par l'Algérie française, oubliant les promesses faites par leurs prédécesseurs.
- Puis, en 1969, le territoire de Ifni est libéré des Espagnols et réintègre le Maroc.
- Le roi Hassan II échappe à deux attentats en 1970 et 1971, préparés par des militaires qui veulent renverser le régime.
- En 1973, des Marocains sahraouis créent à Marrakech le front Polisario pour libérer le Sahara marocain, dit Sahara occidental, des Espagnols.
- En 1975, le roi Hassan II appelle à la "Marche verte" : le 6 novembre, 350 000 volontaires traversent pacifiquement les frontières fictives établies par les Espagnols au nord de Saguia El Hamra et libèrent Laâyoune.
- Le 14 novembre, en signant les accords de Madrid, l'Espagne reconnaît la souveraineté marocaine sur ses territoires sahariens.
- Dès lors, l'opposition se groupe en rangs serrés autour du réunificateur de la patrie, et le Polisario, soutenu par l'Algérie et la Libye, combat le Maroc. La province de Oued Eddahab (Rio de Oro) sera ensuite reprise de la Mauritanie le 14 mai 1979.
- Les années 80 sont une consolidation des acquis et une union des forces nationales. Toutefois, la sécheresse sévit et des manifestations sociales éclatent et sont étouffées par les autorités, ce qui amène le Maroc à adopter un Programme d'Ajustement Structurel de 10 ans qui aggrave la condition des couches sociales défavorisées mais affermit l'économie.
- La situation des droits de l'homme est catastrophique et la liberté d'expression inexistante. Les prisonniers d'opinion sont nombreux et plusieurs hommes politiques s'exilent.
- En 1988, le référendum d'autodétermination sur le Sahara, proposé par Hassan II, est approuvé par l'ONU et l'OUA puis par le Polisario qui accepte le cessez-le-feu. Et pour unir le Maghreb, le roi propose l'Union du Maghreb Arabe qui sera officialisée en février 1989 à Marrakech entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie.
- Avec la dernière décennie du siècle, le Maroc sort de son PAS, le roi institue le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme puis le Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir, les médias sont de plus en plus libres, des prisonniers d'opinion sont libérés (destruction du bagne de Tazmamart), la constitution de 1972 est amendée par référendum en 1992 et des élections générales ont lieu en 1993.
- En parallèle, les infrastructures sont améliorées et les gouvernements entreprennent l'électrification du monde rural, le branchement des douars à l'eau potable puis l'alphabétisation des enfants.
- Depuis 1994, le pays est en continuel chantier : la libéralisation et les réformes à entreprendre sont nombreuses et coûteuses.
- La guerre du Golfe porte un coup dur au tourisme, affaibli encore plus par l'attentat de Marrakech en 1995 qui provoque la fermeture des frontières marocaines aux ressortissants algériens.
- La société civile se réveille grâce aux ONG qui sont rapidement très nombreuses et touchent à tous les domaines d'activité (droits de l'Homme, éducation, économie, corruption, société...).
- La liberté des médias est totale et les partis politiques foisonnent, une presse bilingue de qualité se dégage du lot, avec même des titres en anglais ou espagnol, et une classe moyenne émerge.
- Les gouvernements qui se succèdent jusqu'en 1997 révisent les lois, renforcent les relations bilatérales avec l'Europe et les E.-U. et privatisent nombre d'établissements et entreprises étatiques.
- Grâce à la réforme constitutionnelle de 1996, des élections générales se tiennent en septembre 1997 et l'opposition obtient la majorité des sièges au parlement, redevenu bicaméral. Un gouvernement socialiste avec en tête les partis de l'Istiqlal et de l'USFP (ex-UNFP) est constitué début 1998.
- Les socialistes poursuivent les réformes commencées par les gouvernements précédents et modernisent la justice.
- Signe de progrès, le roi Hassan II amnistie près de 400 prisonniers d'opinion, notamment des islamistes, et le gouvernement, en collaboration avec des ONG, divulgue le sort des anciens prisonniers disparus.
- De nos jours, la société marocaine avance de plus en plus, même si les disparités régionales ou sociales ne disparaissent jamais totalement. Cependant, le pays se développe rapidement à tous les niveaux : culturel, technologique ou humain.