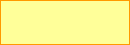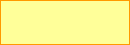- Chaque ville impériale de ces cités mythiques a été fondée par une grande dynastie arabe ou berbère qui, à un tournant de l’Histoire, en a fait sa capitale.
- Lorsqu'une dynastie marocaine choisit sa résidence à Fès, Marrakech, Rabat ou Meknès, la cité, devenue capitale (âsima).
- Accueillant désormais la vie officielle du roi, avec ses réceptions et son cérémonial, ainsi que sa vie privée.
- Les quatre villes impériales du Maroc présentent toujours le même schéma : une structure urbaine dense, resserrée entre des remparts flanqués de tours de guet et de défense.
- Ces cités obéit à des impératifs issus d'une logique spécifique:
- extériorité de la casbah (la citadelle du prince),
- position centrale de la grande mosquée,
- ségrégation religieuse et ethnique,
- différenciation des quartiers à vocation économique et résidentiels,
- localisation des activités en fonction de la pollution qu'elles engendrent.
- La médina, la ville historique, est donc un lieu ouvert à la circulation, dont les lieux privilégiés sont la ou les grandes mosquées, les souks et la casbah.
- Les activités polluantes sont souvent installées à proximité des lieux appropriés - points d'eau -, loin du centre, tandis que la fabrication et la vente des produits de luxe sont établies près de la mosquée.
- La qissariya occupe traditionnellement une position centrale, elle est constituée d'un ensemble de constructions ayant un plan assez régulier.
- Les commerçants y sont également regroupés par spécialités selon la nature des produits vendus.
- En dehors des établissements industriels comme les moulins, les tanneries, les huileries, les ateliers de tissage, qui exigent des installations spéciales, connaît deux sortes de structures:
- la boutique (hânût), principal local des artisans et commerçants, favorisée par la création de nouveaux souks par simple juxtaposition de boutiques.
- le fondouk, ou caravansérail, est un bâtiment à fonctions multiples servant tantôt à loger les caravanes et les voyageurs.
- Réseau souterrain de canalisations a été installé pour desservir les mosquées, les habitations et les fontaines.
- Dans toutes les villes impériales, les fontaines publiques (seqqâya), luxueusement décorées, sont un élément esthétique de la rue ou du souk. Leur aspect pas changé depuis des siècles.
- les ruelles tortueuses et quelquefois couvertes sont réservées aux habitants; le visiteur rural ou étranger.
- Des équipements de base de la vie quotidienne, four (ferrâne), hammam, école coranique (Msid), épicerie (baqqâl), sont installés ; pas de commerce de luxe en revanche dans le quartier.
- La Grande Mosquée est le lieu du culte, l'université, le tribunal, l'asile inviolable, l'espace de convivialité où doivent se remplir sans obstacle les devoirs envers Dieu et envers les hommes.
- La coutume autant que la loi lui prescrit de clôturer la terrasse et l'empêchent d'aménager des fenêtres et des portes donnant vue sur la terrasse ou sur la cour de la famille voisine.
- Les murs qui entourent la cour sont souvent les seuls endroits où l'on voit apparaître une ornementation plus ou moins raffinée. À mesure que la richesse grandit, le décor multicolore des zelliges, du plâtre sculpté, de la mosaïque foisonne.
- Les dimensions de la cour et sa décoration sont des signes de distinction sociale.